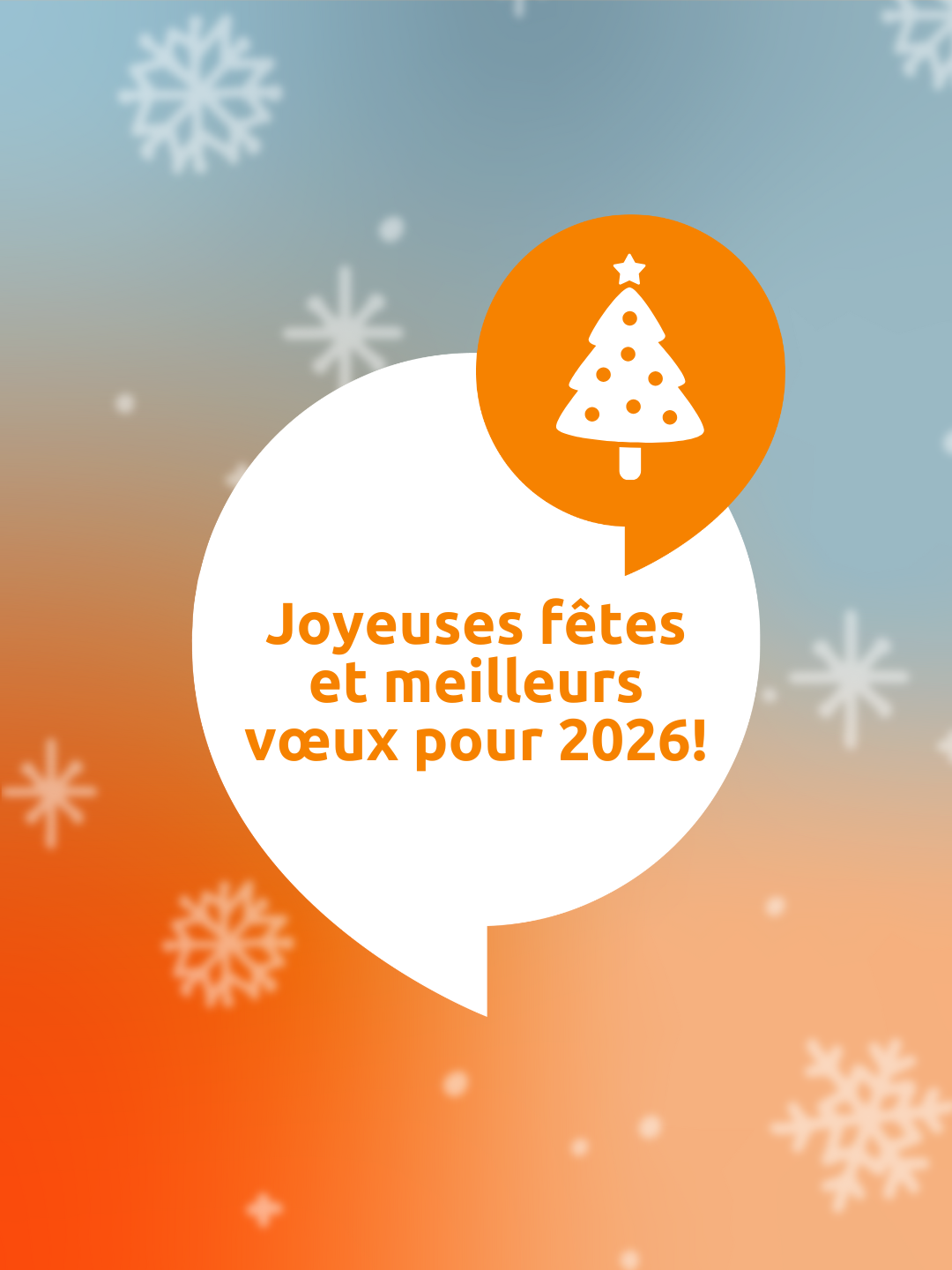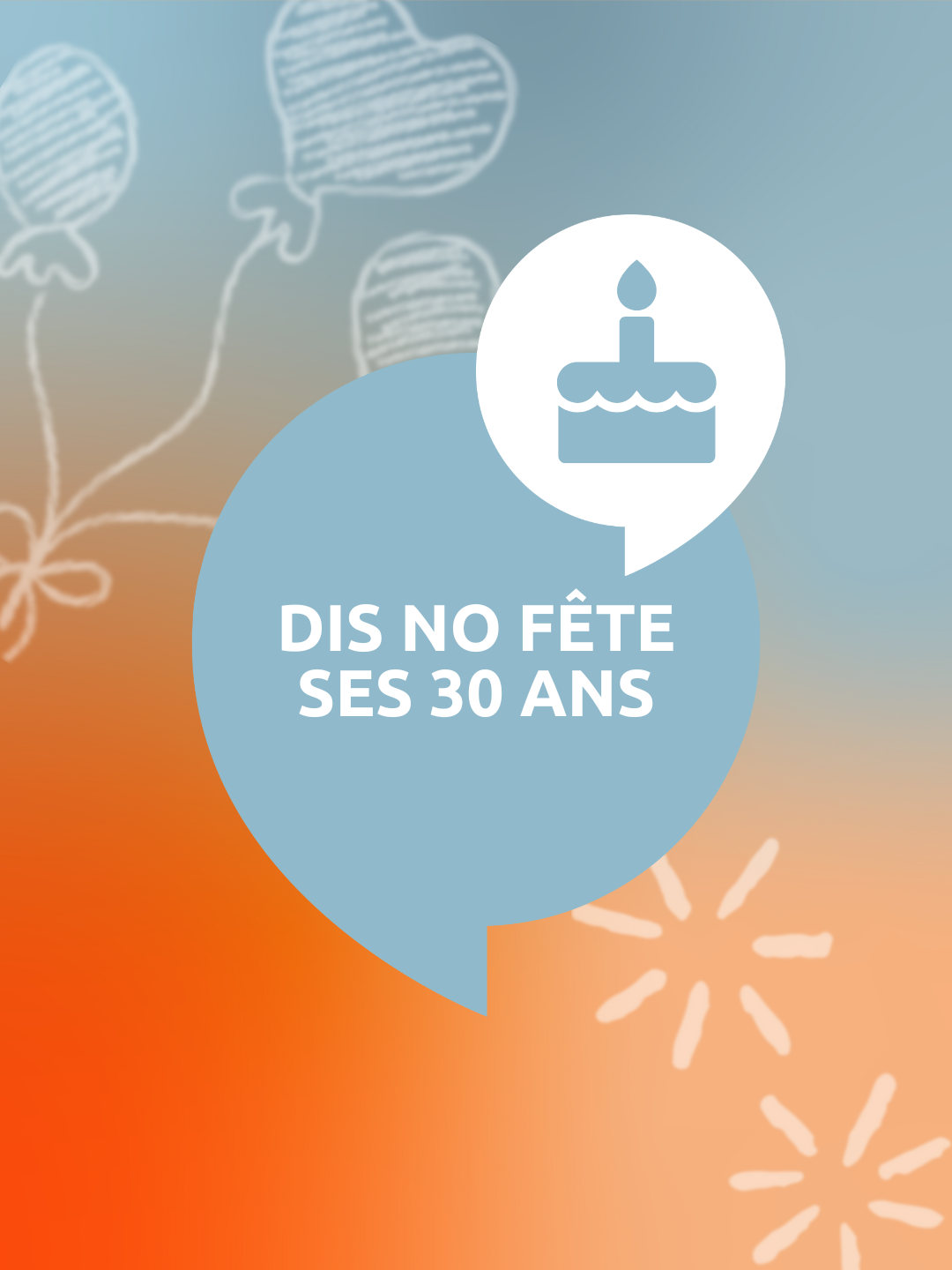La pédophilie : ultime tabou
L’attirance envers les mineur·e·s fait partie des sujets les plus tabous. En plus de toucher à la sexualité, cette attirance va à l’encontre des normes et valeurs sociétales. La simple mention de ce sujet suscite de fortes réactions émotionnelles et de rejet.
La stigmatisation inclue les attitudes et comportements négatifs, les préjugés et les stéréotypes envers une personne ou un groupe considéré comme déviant ou s’écartant de la norme. En ce qui concerne la pédo-hébéphilie, l’image du monstre est fréquente dans l’imaginaire collectif. Cette image se retrouve aussi souvent chez les personnes concernées et leurs proches. L’amalgame entre l’attirance d’ordre pédo-hébéphile et les actes d’ordre sexuel sur mineur·e·s renforce également la stigmatisation.
Un obstacle à demander de l’aide
Chez les personnes concernées par une attirance pédo-hébéphile, la peur d’être rejeté·e, jugé·e, voire dénoncé·e, mais aussi les sentiments de honte et de culpabilité qu’elles ressentent, sont des facteurs qui entravent la demande d’aide. Il est très difficile de trouver un soutien auprès de son entourage pour ce type de préoccupations ou d’identifier les professionnel·le·s à même d’entendre une telle demande d’aide.
Le fait d’amalgamer la problématique des abus sexuels avec celle de la pédophilie alimente le stigmate déjà présent, et représente un frein considérable à la recherche d’aide pour les personnes qui ne sont pas passées à l’acte.
L’importance d’être accompagné·e
Les personnes concernées par ces attirances, considérées comme déviantes, font souvent face à une souffrance et à un isolement important.
Les études scientifiques ont montré que les personnes concernées par une attirance pédo-hébéphile ont tendance à avoir une vision négative d’elles-mêmes accompagnée d’une faible estime de soi, d’une détresse psychologique, d’isolement et parfois de symptômes dépressifs, anxieux, voire d’idées suicidaires. La stigmatisation liée à la problématique peut également entrainer des difficultés de régulation émotionnelle, un retrait social, ou encore l’utilisation de substances. Les personnes avec une attirance pour les mineur·e·s sont donc plus exposées à d’autres difficultés de santé mentale.
Les aides existantes
Les services d’aide de première ligne proposent une écoute non-jugeante et un soutien confidentiel, voire anonyme. En ce sens, ces services représentent souvent un premier pas vers une demande d’aide. Ils permettent aux personnes concernées de nommer leurs préoccupations dans un cadre non-jugeant, de faire diminuer leur isolement et le tabou qui pèse autour de la problématique, et de poser les premiers jalons vers le changement.
Il existe des professionnel·le·s qui proposent une aide psychothérapeutique aux personnes concernées pour leur apprendre à gérer leur attirance au quotidien et à apaiser la souffrance associée. Cet accompagnement permet de protéger la personne concernée par une attirance d’une infraction, de ses conséquences, et ainsi d’éviter de potentielles victimes.
L’accompagnement thérapeutique réalisé s’axe généralement sur deux plans : réduire le risque de passage l’acte et améliorer la qualité de vie de la personne. Le suivi sera adapté selon les besoins spécifiques de cette dernière. Il peut notamment s’agir de renforcer les capacités d’auto-régulation et les ressources, d’améliorer l’estime de soi et les capacités relationnelles (par le soutien social), et de renforcer les capacités à gérer les pulsions sexuelles et les émotions.
Des communautés d’aide et des modules d’auto-assistance en ligne existent également ; elles visent à diminuer le stigmate et à partager des ressources d’aide et d’informations.